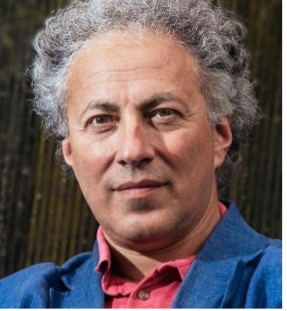La critique historique : une méthode mais aussi un rempart ?
FNRS.news 124 - Le flipbook du numéro
Dossier
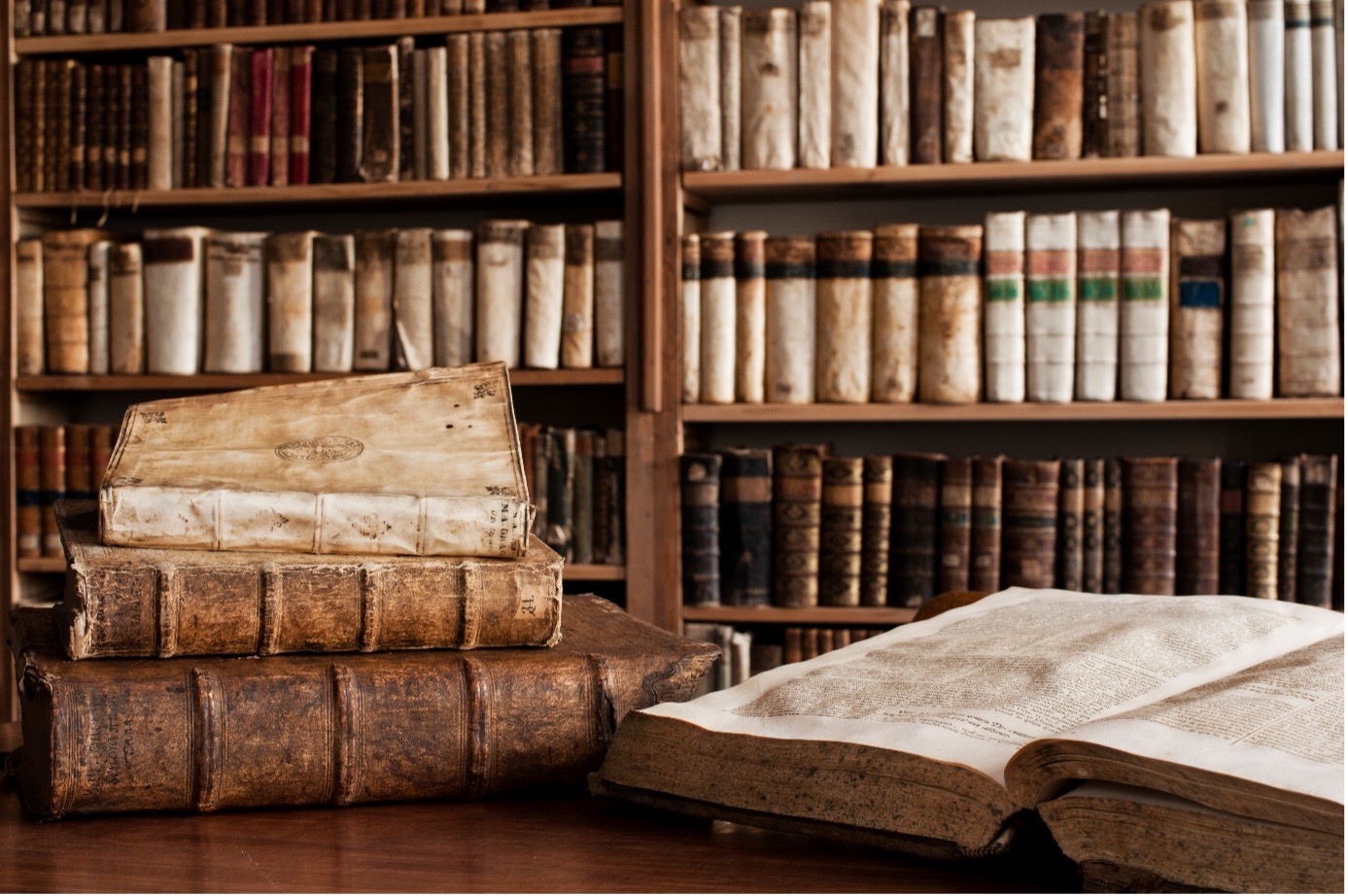
La critique historique : une méthode mais aussi un rempart ?
De Karl Popper à Paul Veyne, il s’est peu à peu imposé que l’histoire était un « roman vrai ». Entendons par là que l’histoire est une telle accumulation de créations en tous genres, d’événements, de comportements, d’intentions, de discours et de tant d’autres productions humaines (et même, pour certains, animales voire végétales) que l’on ne peut qu’en donner un éclairage nécessairement partiel.
En collaboration avec
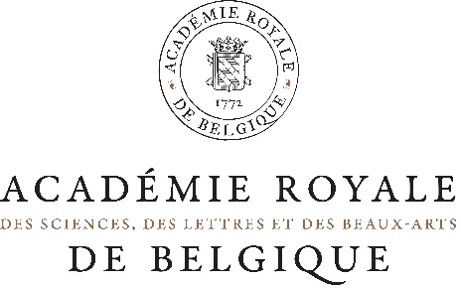
Une part du travail de l’historien consiste alors à rendre intelligible un passé qui ne répond pas à des lois ni même à des règles, qu'il conviendrait de découvrir pour en expliquer l’évolution globale, voire en déduire l’avenir. Le récit historique n’a donc rien à voir avec la description d’un phénomène physique ou chimique que l’on aurait perçu dans son ensemble, objectivé et dont l’existence ou le comportement répondrait, par lui-même et mécaniquement, à une loi. Non pas qu’il n’y ait pas de constantes en histoire. Non pas que l’on ne puisse établir une récurrence d’effets à partir de causes semblables. Mais la diversité des approches envisageables déplace sans cesse le point de vue sur l’enchaînement des faits. Il n’en demeure pas moins que, quelle que soit la part de subjectivité à l’œuvre dans l’angle de description choisi, ce « roman » doit être vrai et, à défaut, le plus probable. Le récit historique n’est donc pas une libre lecture d’un choix d’éléments (événements ou intentions) dont on ne pourrait démontrer la réalité. Son souci est bel et bien, en tout premier lieu, la vérité, c’est-à-dire l’adéquation au réel, et, à tout le moins, la validité des matériaux sur lesquels repose un raisonnement qui s’efforcera, lui aussi, de répondre à des impératifs logiques et documentés très stricts. On distingue ainsi souvent une démarche analytique (qui établit la documentation, pour le dire rapidement) et une démarche synthétique (qui tisse une intelligibilité entre les faits).

Didier Viviers, Secrétaire perpétuel de l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique
« La critique historique subit de plein fouet la déconstruction post-moderne, qui met en doute la notion même de vérité. »
Tant l’approche analytique que la réalisation d’une synthèse historique répondent à des méthodes précises que l’historien se doit d’appliquer et que l’on a pris l’habitude, depuis au moins le début du 19e siècle, d’appeler « critique historique ». Ces techniques ont évolué au fur et à mesure que la documentation de l’historien s’élargissait, du document écrit aux vestiges archéologiques, en passant par les sources orales ou visuelles, des récits aux tableaux de chiffres, de la littérature à la documentation grise, pour ne citer que quelques champs d’ouverture. En fait, l’évolution du métier d’historien a surtout consisté en un enrichissement des sources qui, souvent, ouvrait vers de nouveaux domaines d’enquêtes. Mais dans tous les cas, le principe de base demeure le souci de la source première à laquelle il convient de faire subir une intense critique afin d’en établir la validité et la fiabilité, tout comme le degré de pertinence par rapport à la question posée.
On peut donc aisément considérer que ces techniques offrent un rempart contre la propagation des fake news, qui ont existé de tous temps, mais constituent aujourd’hui un usage presque banal. La critique historique n’est-elle pas rôdée à la détection du mensonge ? Et l’on pourrait alors se satisfaire de cette solution, d’ailleurs largement et magnifiquement appliquée par certains médias, contre ce terrible fléau que représente l’invention d’une « vérité alternative ». Mais si je reprends ici cette expression qui cache mal sa perversité, c’est que la critique historique subit de plein fouet la déconstruction post-moderne, qui met en doute la notion même de vérité en prétendant utiliser le principe de la critique (ou même de l’hyper-critique). Ainsi, les complotistes se déclarent-ils fréquemment les champions de la méthode critique, s’appliquant à critiquer les thèses communément acceptées par celles et ceux qu’ils qualifient alors de crédules. Et ce n’est pas le moindre des paradoxes que de voir ainsi ces complotistes de tous bords construire, au nom de la critique, leur « vérité alternative ». Comme l’écrivait récemment Pierre-André Taguieff, « la grande ruse des complotistes aguerris, c’est de monopoliser la posture critique, au point de se présenter comme l’incarnation même de l’esprit critique, rejetant tous les dogmes et ne respectant aucun tabou ». Or, il faut insister sur le fait qu’il ne s’agit pas là d’une démarche critique, mais plutôt de ce que Taguieff appelle une « radicalisation du soupçon ». Car il faut en revenir à ce qu’écrivait Marc Bloch dans l’un des livres les plus inspirants sur le métier d’historien : « Le scepticisme de principe n’est pas une attitude intellectuelle plus estimable ni plus féconde que la crédulité, avec laquelle d’ailleurs il se combine aisément dans beaucoup d’esprits un peu simples[1] ».
Il faut donc redire que le soupçon systématique ne fonde pas à lui seul une méthode. Au contraire, toute la finesse de la critique historique consiste, sur la base d’une observation précise et d’un travail de validation qui ne répond à aucun autre objectif que celui d’établir la crédibilité d’une source, à doser, mesurer, argumenter, comparer, contextualiser, sans juger et tout en reconnaissant ses doutes comme les vides de notre connaissance. Les « outils de l’historien » restent très efficaces, pour peu qu’on les maîtrise en profondeur. Établir les faits requiert des compétences techniques, étudier les traces laissées par nos prédécesseurs impose une infinie tolérance et une profonde curiosité, distinguer les témoignages volontaires de ceux qui ne le sont pas constitue l’une des bases de la critique historique, et un angle de lecture des données qui nous entourent tout particulièrement riche.
Aussi, doit-on maintenir et étendre les cours de critique historique bien au-delà des cursus d’histoire proprement dits. C’est souvent le cas en Belgique, du moins pour les sciences humaines et sociales, même si le titre varie ; ce l’est aussi fréquemment en Allemagne ou en Suisse, un peu plus rarement en France, à l’exception de Sciences-Po, mais ce l’est de moins en moins ailleurs. Même dans les cursus d’histoire des pays anglo-saxons, la critique historique n’apparaît que rarement enseignée en tant que telle. On dira qu’elle s’enseigne par la pratique du métier, mais ce n’est peut-être pas suffisant à une époque où il est important de formaliser les principes méthodologiques si l’on veut les renforcer. Le risque est grand de tout concentrer sur la maîtrise des théories qui déterminent la synthèse des faits sans prendre la peine d’affiner les techniques de critique des sources sur lesquelles reposent l’établissement de ces mêmes faits. D’autant plus que l’hyper-numérisation des données modifie à nouveau en profondeur la nature des documents à traiter et, partant, les techniques à développer pour en assurer à la fois la collecte et la critique. C’est là bien plus qu’une question de pratique. C’est avant tout une question de méthode qui nécessite d’être posée en tant que telle. Marc Bloch considérait, dans ce même ouvrage écrit en captivité durant la 2e guerre mondiale, que « tout livre d’histoire digne de ce nom devrait comporter un chapitre (…) qui s’intitulerait à peu près : ‘Comment puis-je savoir ce que je vais dire ?’ »[2]. Cette exigence semble revêtir une forte actualité et on ne s’en étonnera pas de la part d’un historien qui était tout particulièrement conscient de sa responsabilité sociale.
Didier Viviers
[1] Apologie pour l’histoire ou Métier d’historien, Paris, 1949 [2e éd. 1952], p. 35.
[2] Op.laud., p. 30
L’intro et le sommaire du dossier : Sur les traces de la méthode scientifique