FNRS.news 124 - Le flipbook du numéro
Dossier

Méthode scientifique : une longue histoire toujours en cours
Vue de notre 21e siècle, l’histoire des sciences et des méthodes ressemble à une route sinueuse, mais, somme toute, assez cohérente. Depuis quelques années cependant, les historiens donnent à voir une facette beaucoup plus hétérogène, et aussi beaucoup plus riche de la manière dont les sciences se sont construites, tant les disciplines ont évolué à des rythmes différents.
À quand remonte la méthode scientifique ? Les premières traces de ce que l’on considère aujourd’hui comme tel remontent à l’Égypte ancienne, près de 1600 ans avant J.-C., avec le papyrus Edwin Smith. Ce texte médical, nommé d’après le collectionneur américain qui fut un temps en sa possession, est principalement un traité de chirurgie de guerre adressé aux praticiens de l’époque. Mais c’est au 7e siècle avant notre ère que Thalès, avec le calcul de la hauteur de la pyramide via son ombre, établit ce qui est considéré comme la première loi scientifique de l’humanité. On attribue d’ailleurs aux Grecs la démonstration mathématique, qui consiste à réaliser une déduction rigoureuse pour arriver à la preuve. Pythagore, puis Euclide, 300 ans avant J.-C., en établiront tour à tour des versions plus élaborées. Le développement du raisonnement déductif va culminer avec Platon, et plus encore avec son élève, Aristote. Le philosophe grec s’intéresse à tout : biologie, physique, cosmologie… Il existe des dizaines de textes détaillant sa méthode. Parmi eux, on trouve l’Organon, consacré à la logique et à l’observation du monde afin d’en déduire des lois générales. Pour Aristote, des vérités universelles peuvent être déduites de l’observation de choses particulières, pour autant que ces dernières soient représentatives de ce qui se passe « habituellement, ou la plupart du temps ».
L’apport de la science arabe
Après sa mort, ses travaux seront enseignés dans le fameux Lycée à Athènes, et ils connaîtront une seconde vie, décisive pour l’histoire des sciences. Mais on ne peut quitter l’Antiquité sans parler d’une autre figure majeure : Galien. Ce médecin grec, né en 129 après J.-C., « a fondé la médecine qui sera enseignée au Moyen-Âge et jusqu’au 18e siècle », explique l’historienne Élisabeth Moreau, Chargée de recherches FNRS à l’ULB. « Il a instauré une méthode, centrale dans la pratique médicale, basée à la fois sur une approche rationnelle du savoir et sur l’expérience, qui consiste à appliquer ce savoir au patient. » Si Galien a acquis une telle renommée, y compris de son vivant, cela tient à la dimension colossale de son œuvre. « Il a organisé tout le savoir médical, détaille Élisabeth Moreau. L’anatomie et la chirurgie, bien sûr, mais également la physiologie, la thérapeutique, la pharmacologie… »

Elisabeth Moreau, Chargée de recherches FNRS, Centre de recherches Histoire, Arts et Culture des Sociétés anciennes, médiévales et modernes (SOCIAMM), ULB
« Il existe quelques figures qui ont complètement remis en cause l’autorité des Anciens, comme Paracelse, qui renie Galien et sa méthode, et pour qui seule comptait l’expérience alchimique. »
Avec son déclin au 5e siècle, l’influence de l’Empire romain d’Occident reflue également dans le domaine des sciences, et les centres de connaissances se déplacent vers l’Est, jusqu’au monde arabe. Les savants s’y approprieront les textes d’Aristote, Galien et d’autres, et les feront vivre bien au-delà de ce qu’on a appelé l’âge d’or de la science arabe. « Les médecins de langue arabe, comme Avicenne par exemple, ont systématisé l’œuvre de Galien en l’intégrant dans une médecine pratiquée à la fois comme un art et comme une science », résume Élisabeth Moreau. La science arabe se distingue également de la méthode d’Aristote en apportant l’empirisme, basé sur l’expérimentation. Le savant perse al-Biruni insiste même sur le caractère répété de l’expérimentation afin de produire des données fiables. Selon lui, l’universel provient du pratique et les théories sont formulées après les découvertes.
L’Occident, quant à lui, opère au 12e siècle une certaine renaissance au contact de la culture musulmane et les auteurs grecs seront largement enseignés dans les universités tout au long du Moyen Âge et de la Renaissance, formant ainsi l’enseignement scolastique. La période allant du 15e au 17e siècle a longtemps été nommée « Révolution scientifique », comme une sorte de bulle temporelle où les Modernes, menés par les fers de lance que sont Galilée et Descartes, auraient rejeté l’enseignement scolastique et réinventé la manière de penser. Or les historiens remettent aujourd’hui largement en cause cette vision des choses : « La plupart des auteurs que l’on considère comme les grands penseurs de la Révolution scientifique s’inscrivent largement dans la tradition de leur époque, confirme Élisabeth Moreau. Vésale, par exemple, qui est encore perçu comme ayant complètement remis en cause le corpus de l’anatomie humaine, se voyait largement comme un galéniste ». Il en va de même pour Harvey, découvreur de la circulation sanguine, ou de Copernic, qui a gardé d’Aristote la notion de perfection divine du mouvement circulaire des planètes.
La « Révolution scientifique » : une rupture relative
Il apparaît donc que la Renaissance a surtout commencé par une remise en cause de la façon d’obtenir un savoir. « La méthode scientifique doit en réalité être entendue comme des méthodes scientifiques et, par là même, comme des champs de lutte socio-politiques », souligne l’épistémologue Camille Chamois, Chargé de recherches FNRS à l’ULB. Car en réalité, les Modernes contestaient l’Aristotélisme et non Aristote lui-même. Pour le comprendre, il faut retourner au contexte historique qui illustre à quel point les métamorphoses politiques, culturelles, anthropologiques et religieuses ont partie liée avec le rapport au savoir. À partir du 15e siècle, l’Europe passe d’une crise à l’autre. Il y a d’abord l’émergence d’États-nations forts, qui sont continuellement sur le pied de guerre. Parallèlement, l’invention de l’imprimerie accélère de manière inédite la diffusion des idées, des sciences et des techniques, par l’intermédiaire d’écrits en latin, mais aussi en français, ou en italien. Descartes lui-même a écrit en 1637 son Discours de la Méthode en français, « afin que tous ceux de bon sens, y compris les femmes, puissent le lire ». L’exploration du Nouveau Monde est également un choc, culturel et économique, qui remet en cause la vision aristotélicienne du monde. Sans oublier la fragmentation de l’ordre religieux européen qui, suite à la réforme protestante du 16e siècle, entraîne un affaiblissement de l’autorité cléricale.

Camille Chamois, Chargé de recherches FNRS, Département d'enseignement de Philosophie, Éthique et Sciences des Religions et de la Laïcité (PHILO), ULB
« Nous assistons depuis quelques décennies à la multiplication d’études transdisciplinaires. Des questions contemporaines nécessitent le secours de plusieurs disciplines distinctes. »
Dans ce climat de grands bouleversements, propre à engendrer un climat de scepticisme, les Modernes entendaient aller chercher eux-mêmes la connaissance dans « le Grand Livre de la Nature », et ne plus faire confiance aveuglément aux universitaires qui, à force de traductions et d’annotations, auraient dévoyé le savoir des Anciens. « Il existe également quelques figures qui ont complètement remis en cause l’autorité des Anciens, comme Paracelse, qui renie Galien et sa méthode, et pour qui seule comptait l’expérience alchimique », note Élisabeth Moreau. Les textes de ce dernier, médecin suisse mort en 1541, ont créé la polémique dans toutes les facultés de médecine, et ont débouché sur une série de traités tentant de conjuguer les deux approches. Aujourd’hui, Paracelse n’est plus guère enseigné au côté des grands penseurs. « Pourtant, on ne peut nier qu’il a donné naissance à des idées originales, comme à Marbourg, où l’université a été la première à ouvrir une chaire de médecine paracelsienne, basée sur un enseignement non seulement théorique mais également pratique avec un laboratoire d’alchimie », précise l’historienne.
La période de la Révolution scientifique, censée culminer avec les travaux de Newton sur la gravitation en 1687, présente finalement un tableau très hétérogène de pratiques et de connaissances, où les savoirs anciens cohabitent avec les modernes, et très différent de notre science contemporaine. « Les sciences sont avant tout des dispositifs socio-techniques, explique Camille Chamois. Les scientifiques ne sont pas dans un monde éthéré, mais bien dans des lieux liés à la société dans son ensemble, et donc très dépendants du contexte de leur époque. »
Des sciences à la Science
Plus proche de nous, c’est finalement surtout le « grand 19e siècle », allant de 1789 à 1914, qui consacre la science et la méthode scientifique au sens où on l’entend aujourd’hui. Les écrits scientifiques s’étaient propagés à de nouvelles couches de la société, grâce aux Lumières qui répertorient l’ensemble des savoirs avec les Encyclopédies, mais aussi via l’augmentation exponentielle des revues scientifiques et du journalisme de vulgarisation, popularisant les nouvelles sciences. Le 19e siècle voit en outre apparaître des méthodes d’analyse systématiques des champs de savoirs et, dès 1830, « les sciences deviennent "La Science", et la biologie, les mathématiques et la physique sont embarquées dans la notion de Progrès », résume Camille Chamois. Avec notamment l’invention d’un nouveau terme pour une nouvelle profession : scientifique.
La méthode elle-même devient une sorte de boîte à outils commune. La chimie évolue en science de la combinaison des éléments élémentaires, tout comme la médecine avec les tissus, ou la géologie avec les strates. La précision devient importante avec la standardisation des unités de mesure. Cette obsession des nombres se retrouve également dans les statistiques, qui vont devenir un puissant outil pour cette nouvelle science qu’est la sociologie. « En France notamment, les nouveaux sociologues se sont détachés des historiens en dédaignant les évènements uniques pour s’intéresser aux régularités comme les mariages, les divorces ou les inégalités de revenu, avec la volonté de dégager les lois qui gouvernent le fonctionnement des sociétés », explique le sociologue Jean-Michel Chaumont, Chercheur qualifié FNRS à l’UCLouvain, en référence à Durkheim et à son étude sur le suicide. Cette vision n’était cependant pas partagée par tout le monde, « comme Max Weber qui, sans dénigrer les statistiques, considérait que la compréhension des mouvements sociaux passait par celle de leur signification-même pour les acteurs impliqués », précise le sociologue. Un appui sur des méthodes à la fois qualitatives et quantitatives qui perdure encore aujourd’hui.

Jean-Michel Chaumont, Chercheur qualifié FNRS, Institute for the Analysis of Change in Contemporary and Historical Societies (IACS), UCLouvain
« La science semble toujours s’être enrichie lors de l’intégration de nouvelles populations. »
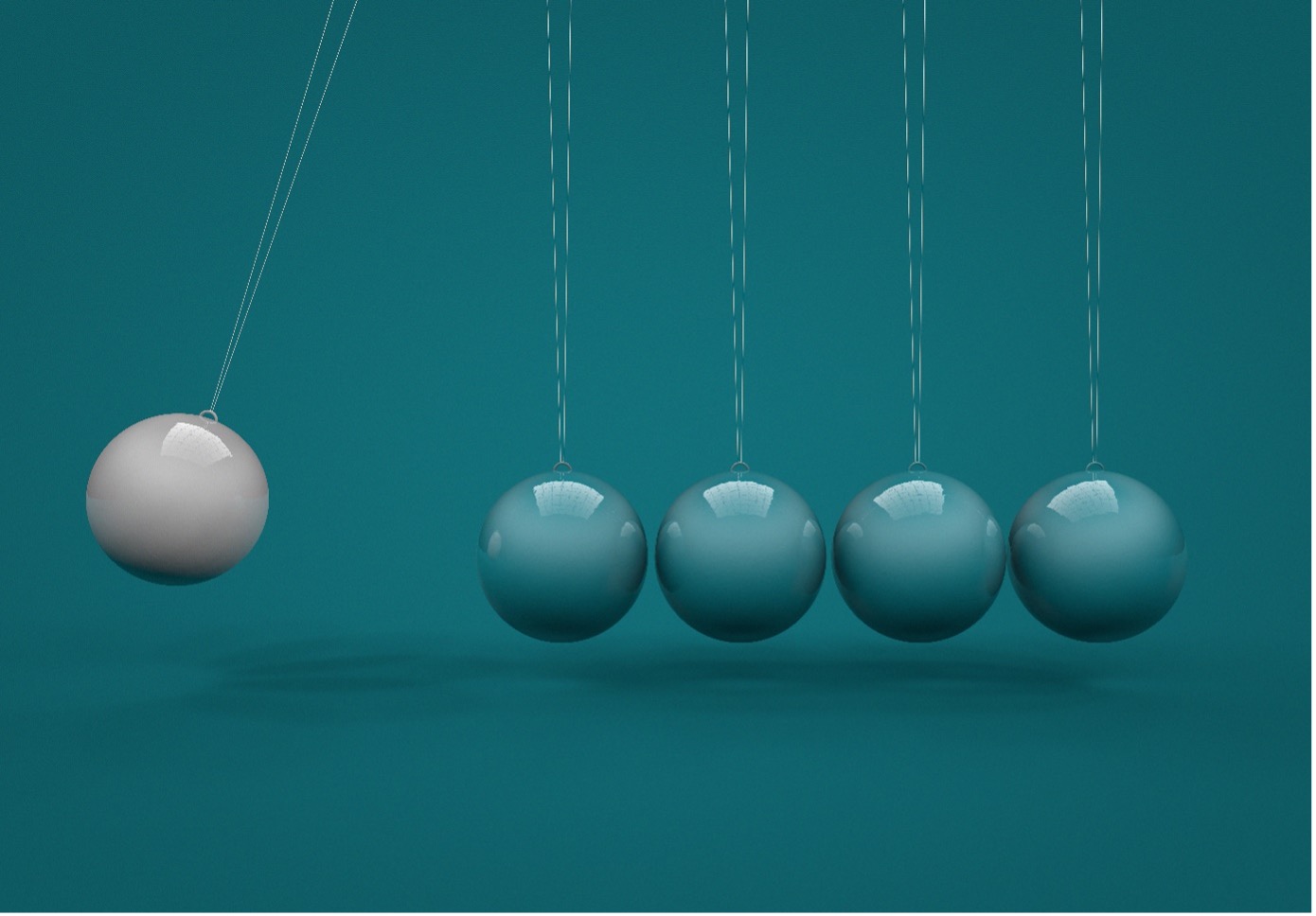
Méthode hypothético-déductive
Mais, par-delà son évolution historique, la question fondamentale subsiste : peut-on assigner à la méthode scientifique des fondements qui engloberaient à la fois la philosophie, la physique, la biologie, l’histoire, la médecine… ? L’étymologie de ce terme d’origine grecque (« methodos ») peut nous offrir un premier secours : « la méthode est la poursuite, la recherche, l’élaboration de chemins par lesquels on aborde des réalités ou des problèmes », avance Benoît Timmermans, Maître de recherches FNRS à l’ULB.
Benoît Timmermans, Maître de recherches FNRS, Centre de recherches en Philosophie (PHI), ULB
« Au sein de la transdisciplinarité, les discussions sur les méthodes de recherche et de communication des résultats sont constantes. »
« Une définition, somme toute assez triviale, de la méthode scientifique revient à dire qu’il s’agit d’une manière de produire des savoirs, poursuit Louis Carré, Chercheur qualifié FNRS à l’UNamur. Malgré sa généralité, cette définition permet de distinguer la méthode de ce qu’elle produit. La méthode produit des objets de science qui, en retour, dirigent la recherche, dans un jeu constant de va-et-vient ». Difficile, selon Louis Carré, d’aller au-delà de cette généralité sans trahir la complexité à l’œuvre. « On réduirait alors la méthode scientifique à une unité, ce que j’appelle une tentation réductionniste, commente-t-il. Face à la division des sciences en diverses disciplines, cette tentation cache une volonté de réduire certaines disciplines. Pour y arriver, il faudrait parvenir à définir un dénominateur commun aux différentes sciences, ce qui contient en germe une forme de hiérarchisation, comme celle implicite entre des sciences dites "exactes" et des sciences dites "humaines". Comme si les premières pouvaient seules prétendre à l’objectivité tandis que les autres seraient cantonnées à la subjectivité ».

Louis Carré, Chercheur qualifié FNRS, Espace philosophique de Namur (ESPHIN), UNamur
« L’expression "savoir scientifique" n’est en rien un pléonasme. »
Là encore, l’histoire nous offre un éclairage essentiel. « Quelques grandes étapes permettent d’éclairer le développement des méthodes scientifiques », précise Tom Dedeurwaerdere, Maître de recherches FNRS à l’UCLouvain. « Au 17e siècle, Galilée élabore une méthode fondée sur l’observation et l’expérimentation. Il crée alors un cadre théorique permettant d’expliquer un ensemble de phénomènes, un cadre unifiant qui permettait d’appréhender la réalité ». Ce mouvement amène au quadrilatère bien connu « de l’observation, de l’élaboration d’une hypothèse, du test de cette hypothèse et de la déduction de ses conséquences, poursuit Benoît Timmermans, soit la méthode hypothético-déductive. Une approche qui s’accorde avec beaucoup de pratiques. Mais il s’agit d’un mouvement idéalisé et souvent reconstitué après coup, les tests d’hypothèse(s) n’étant pas forcément décisifs et pouvant amener à des réajustements ».

Tom Dedeurwaerdere, Maître de recherches FNRS, Institut supérieur de philosophie (ISP), UCLouvain
« Galilée a créé un cadre théorique permettant d’expliquer un ensemble de phénomènes, un cadre unifiant qui permettait d’appréhender la réalité. »
Les communautés disciplinaires
Pour Tom Dedeurwaerdere, après la révolution galiléenne, un second mouvement structurel dans la méthode scientifique contemporaine apparaît au 18e siècle avec l’émergence des communautés disciplinaires. « Il s’agit de scientifiques qui s’organisent en communautés. Des revues spécialisées commencent à paraître dont la première fut le célèbre journal Philosophical Transactions de la Royal Society au Royaume-Uni, en 1665, couvrant principalement des articles de physique théorique et expérimentale. Ce sont des lieux où les chercheurs confrontent leurs points de vue et discutent autant de leurs résultats que de leurs méthodes de recherche. Par ce biais, les scientifiques vont mettre en place des processus de validation des méthodes afin qu’elles soient établies sur des bases claires et solides ». Cet aspect de communauté se retrouve aujourd’hui formalisé dans le « peer reviewing », étape obligée avant une publication. « Dans certaines disciplines, il n’y a pas tellement de discussions sur la méthode scientifique, comme en mathématique par exemple, avance Benoît Timmermans. Dans d’autres, les débats sont presque permanents, comme en économie qui a même une revue dédiée à ses méthodes de travail, le Journal of Economic Methodology, où se confrontent en permanence plusieurs perspectives méthodologiques. »
Emergence de la transdisciplinarité
Un aspect central de la méthode scientifique serait donc sa constante évolution ; loin d’être un objet figé, elle évolue. « On pourrait dire que la méthode de recherche de certaines disciplines n’évolue que lentement, poursuit Benoît Timmermans. L’accumulation de résultats probants s’appuyant sur une méthode bien définie rend sa modification, ou son évolution, plus difficile. Par contre, nous assistons depuis quelques décennies à la multiplication d’études transdisciplinaires. Des questions contemporaines nécessitent le secours de plusieurs disciplines distinctes. Un bon exemple se trouve dans les rapports d’évaluation du GIEC, traditionnellement divisés en trois grandes parties avec a) les données scientifiques sur le réchauffement climatique, b) les conséquences de ce réchauffement, et c) les moyens d’atténuer ces conséquences. Si la méthode scientifique propre à la première partie ne pose pas énormément de problèmes méthodologiques, on voit clairement que les deux autres mêlent climat, études sanitaires, socio-politiques, économiques, écologiques, etc. Au sein de cette transdisciplinarité, les discussions sur les méthodes de recherche et de communication des résultats sont constantes, de nouvelles méthodes voient le jour quand d’autres sont amendées et amènent des avancées théoriques qui elles-mêmes nourrissent les débats ».
La transdisciplinarité nécessite un apprentissage au sein des espaces disciplinaires. Lorsque des thématiques transversales naissent, il n’y a pas encore de communauté, de revues, de processus de validation des méthodes. Ces dernières sont donc en constante évolution, le temps que cette nouvelle collaboration entre disciplines arrive à maturation, que des chercheurs publient, obtiennent une chaire, etc. « Selon moi, on peut le voir comme une troisième phase dans l’histoire de la méthode scientifique, après l’établissement de la méthode par Galilée et l’émergence des communautés disciplinaires, poursuit Tom Dedeurwaerdere. Particulièrement visible après la Seconde Guerre mondiale, la transdisciplinarité fut rendue nécessaire par des projets de grande ampleur comme le HGP (projet génome humain) ou le GIEC. Un élément spécifique de cette troisième phase est la question des valeurs qui doivent être partagées entre des groupes hétérogènes de chercheurs ou entre chercheurs et acteurs sociaux. En anthropologie, par exemple, il y a la notion de "consentement préalable informé" de la recherche. Si une étude se mène auprès d’un peuple aborigène, il est nécessaire d’informer préalablement du pourquoi, du comment, des éventuels bénéfices à la communauté. »
Une évolution constante
Car la recherche est en interaction avec ses objets et d’autres savoirs. Pour Louis Carré, « le savoir produit par les sciences n’épuise pas le domaine des savoirs ; autrement dit, la science ne dispose pas d’un monopole sur la production des savoirs. L’expression "savoir scientifique" n’est en rien un pléonasme. On pourrait dire qu’il y a le savoir d’expert - le savoir organisé autour de communautés scientifiques - et le savoir profane. Dans la recherche contre le sida, par exemple, des patients atteints par la maladie ont contribué à transformer les méthodes thérapeutiques. La science, ici, a pu évoluer en prenant en compte ces savoirs profanes afin de faire évoluer ses méthodes. »
La méthode scientifique est donc, à l’instar de ses découvertes, en constante évolution, en dialectique permanente entre ses acteurs, réévaluée au gré des nouvelles questions qui émergent dans différentes disciplines ou à la frontière de plusieurs d’entre elles. Et sur certaines questions, « la science se retrouve au milieu d’autres savoirs, poursuit Louis Carré. Distinguer le savoir scientifique du savoir non-scientifique n’est donc pas chose facile. Bruno Latour parle à ce propos d’objets chevelus par contraste avec des objets galiléens considérés comme "purs". Face à des préoccupations très actuelles comme le climat ou la pandémie, des savoirs hétéroclites, plus ou moins scientifiques, s’entremêlent, ce qui contribue à brouiller ou à complexifier les débats. Or le public attend souvent des communautés scientifiques un rôle qu’elles peuvent difficilement tenir : la production de certitudes. Il y a des choses dont on est plus ou moins sûr grâce aux sciences, mais la plupart demeurent incertaines et sujettes à controverses ; un principe critique d’incertitude guide la recherche dans un questionnement permanent sur ses résultats autant que sur sa ou ses méthode(s) de travail. »
Valeurs et vertus
La méthode scientifique ne peut donc pas se réduire à quelques principes simples. En évolution constante, elle connaît des remises en question fréquentes, souvent volcaniques lorsque de nouvelles questions ou de nouvelles disciplines voient le jour. Reste que des valeurs, des vertus doivent fonder l’édifice. La rigueur (la cohérence logique, mais aussi la rigueur dans la collecte ou la réception des données) et l’efficacité (la reproductibilité et la prédictivité par exemple), pour Benoît Timmermans ; les vertus épistémiques, pour Louis Carré, c’est-à-dire l’attachement à la vérité, l’esprit critique, l’inventivité et le scrupule dans l’administration de la preuve. « S’il n’y a pas d’explicitation des valeurs, conclut Benoît Timmermans, il y a perte de la valeur sociétale et un risque de scepticisme généralisé. La méthode scientifique a aussi ses limites. Entre autres exemples, le conditionnement des carrières aux publications crée une pression qui entre en conflit avec la temporalité de la recherche. Il s’agit ici d’une autre fragilité, au cœur du "peer reviewing" ». Une recherche libre, autonome et disposant de moyens suffisants demeure donc la condition pour garantir à la méthode scientifique ses vertueux et valeureux fondements.
Thibault Grandjean et Adrien Dewez
L’intro et le sommaire du dossier : Sur les traces de la méthode scientifique


