FNRS.news 124 - Le flipbook du numéro
Dossier

Un cas d’école
Parce qu’elle ne répond pas aux critères de scientificité couramment admis – falsifiabilité, prédictibilité, universalité des lois, validation expérimentale… –, la validité des recherches en sociologie et sciences sociales a souvent été, comme d’autres, remise en question. Elle n’en reste évidemment pas moins une science, avec ses propres objets, méthodes et enjeux.
Quand on leur soumet la proposition[1] d’une sociologie fondamentale adhérant à un modèle unique de science, visant à produire des lois et modèles reproductibles sur le social (indépendamment des intentions individuelles), les deux chercheurs que nous avons rencontrés ne cachent pas leur scepticisme. « Une sociologie qui ferait abstraction de ce que pensent les individus, c’est le contraire même de la sociologie. Les êtres humains ont une capacité d’agir, de résister, de vivre individuellement et collectivement, qui est irréductible à des lois universelles », analyse le sociologue Marco Martiniello, Directeur de recherches FNRS à l’ULiège. La politologue Florence Delmotte, Chercheuse qualifiée FNRS à l’USL-B explique à son tour que « les sciences sociales ont leurs méthodes propres, parce qu’elles ont leurs objets propres. C’est logique que les méthodes pour étudier les phénomènes qui ont du sens et font histoire ne soient pas les mêmes que celles pour étudier les phénomènes physiques, biologiques ou chimiques ». Tous deux s’accordent à dire que la scientificité de la sociologie ne dépend pas d’une méthode appliquée à la lettre, mais d’une pluralité de méthodes et, surtout, de la remise en question constante de celles-ci et des postures de recherche.
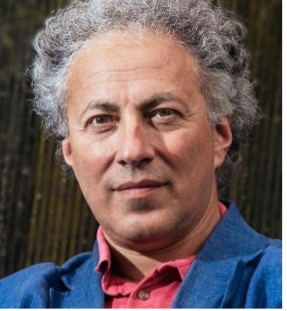
Marco Martiniello, Directeur de recherches FNRS, Centre d'Etudes de l'Ethnicité et des Migrations (CEDEM), ULiège
« Une sociologie qui ferait abstraction de ce que pensent les individus, c’est le contraire même de la sociologie. »
Du quantitatif au qualitatif
Marco Martiniello s’intéresse notamment aux formes d’expression artistique des populations migrantes et minoritaires. Il mobilise majoritairement des méthodes qualitatives – entretiens approfondis, observations participantes, focus groupes… Il avait pourtant commencé comme quantitativiste : « Ma première recherche portait sur la démocratisation du public de l’opéra, qu’on cherchait à évaluer via une grande enquête quantitative par questionnaires : on a pu établir des pourcentages de participants, dégager des profils, etc. Mais ce n’était pas satisfaisant : on ne savait pas ce qui se cachait derrière un "oui, non, je ne sais pas", derrière un refus de participer. Si l’on veut saisir le sens que les individus donnent à leurs actions, il faut aller beaucoup plus loin : dans le dialogue, voire vers une co-création de savoirs. » Florence Delmotte abonde dans ce sens. « Parfois, on se rend compte que les questions posées dans les sondages, dont on déduit un arsenal de conclusions, reflètent davantage les préoccupations de l’enquêteur par rapport à son objet que celles du public visé. »

Florence Delmotte, Chercheuse qualifiée FNRS, Centre de Recherche en Science Politique (CReSPo), USL-B
« Il n’y a pas de lecture universelle ou neutre. Cela demande de se questionner sur notre propre position. »
Tous deux valorisent donc la complémentarité des approches et la combinaison des méthodes : les méthodes qualitatives donnent corps, creusent le sens et réorientent les méthodes quantitatives ; celles-ci apportent des images à grande échelle, des directions générales, permettent de situer les données récoltées au moyen des méthodes qualitatives. Si les deux chercheurs partagent une même vision de la sociologie, les méthodes de Florence Delmotte sont assez différentes, à cheval entre la théorie politique et la sociologique. Membre de l’Institut des études européennes, la chercheuse mobilise les travaux de sociologie historique de Norbert Elias pour penser l’intégration européenne et les rapports des individus à l’Europe. Ses premiers travaux étaient exclusivement théoriques, mais elle précise : « Ne pas faire de terrain ne signifie pas qu’un travail n’a pas d’objet ni de méthode : les miens étaient la théorie même et la question de l’intégration européenne. J’ai adopté la méthode herméneutique : essayer de comprendre le sens des textes, celui qu’ont voulu leur donner leurs auteurs, avant de les utiliser, de les interroger, de les mettre en dialogue et de les actualiser. »
L’objectivité comme horizon
C’est là l’une des spécificités des sciences sociales et de leurs enjeux : tant dans l’approche théorique qu’empirique, le chercheur, impliqué dans le monde social, ne peut s’extraire de son objet – il n’est dès lors jamais « neutre ». L’objectivité du savoir reste néanmoins à l’horizon de la recherche. « La réflexivité face à ses propres positionnements est l’une des conditions de "l’objectivité" en sciences sociales. Je pense qu’il est vain de mettre à distance sa subjectivité, mais qu’il faut au contraire l’expliciter et l’incorporer à la réflexion », explique Marco Martiniello. Cette question, il se la pose chaque jour, lui-même intimement lié à son objet de recherche : « Il a toujours été clair que le fait d’étudier les migrations était lié à mon histoire familiale, mais je ne m’en suis pas contenté. Je reconnais cette subjectivité, mais cela ne conditionne pas nécessairement les analyses. » Tout en insistant : le bagage d’une seule discipline et d’une seule approche méthodologique est insuffisant pour en faire le tour.
Les deux chercheurs ont travaillé au sein d’équipes pluridisciplinaires, une richesse de points de vue qu’ils considèrent non seulement utile, mais indispensable. Dans ses recherches ultérieures sur les dispositifs de démocratie participative à Bruxelles, Florence Delmotte a ainsi travaillé empiriquement aux côtés de politologues, de sociologues, d’anthropologues, mais aussi d’acteurs de terrain. Un « détour par la participation » qui lui a permis de prendre conscience des limites liées à la posture de recherche. Les risques en sciences sociales sont, selon elle, fidèles à la tradition éliasienne de s’enfermer à la fois dans ses propres méthodes (l’hyperspécialisation) et dans une approche synchronique (le présentisme). « Le présent est relié au passé et à l’avenir. Ne pas en tenir compte, c’est une abstraction qui ne correspond pas à la réalité. » Ainsi, mobiliser des auteurs morts au siècle dernier – eux-mêmes ancrés dans une perspective historique – pour comprendre l’intégration européenne, offre pour elle la force du décalage, même si cela semble paradoxal : « Cela nous permet par exemple d’interroger la radicale originalité du projet européen, de remettre en perspective la construction européenne avec d’autres processus d’intégration historiques. »
Recherche et engagement
Une autre critique à l’égard de la scientificité de la sociologie prend de l’ampleur actuellement et est portée notamment par Gérald Bronner[2] et Nathalie Heinich[3], eux-mêmes sociologues. Ces auteurs dénoncent la pénétration d’idéologies dans le champ scientifique, dont la spécificité serait de « se donner la connaissance comme fin en soi, et non une visée d’amélioration morale ou politique de la société », opposant par-là posture scientifique et engagement militant (qui impliquerait des biais de confirmation idéologique). Pour Marco Martiniello, « il faut se méfier en sciences sociales des postures qui dénoncent l’engagement politique des chercheurs, parce qu’elles témoignent souvent d’une autre forme d’engagement. Il pourrait s’agir de tentatives de discréditer certains discours dans un climat politique particulier. » Il se reconnaît volontiers lui-même comme « chercheur engagé » : « Le simple fait d’être sociologue, d’autant plus dans un domaine sensible, fait de moi quelqu’un d’engagé. Car je pense que l’objectif des sciences sociales n’a jamais été la connaissance en soi, mais la production de savoirs qui pourront conduire à l’action en vue de l’amélioration du sort de l’humanité. Bien sûr, je distingue mes activités militantes et académiques, à l’aide justement de méthodes rigoureuses et de réflexivité. Mais rester neutre est illusoire. Comment rester de glace, quand on voit des bateaux sombrer dans la mer ? On ne travaille pas avec des pommes qui tombent à terre ! » Les deux chercheurs en arrivent à la même conclusion : en termes de validité scientifique, davantage que les écueils idéologiques, le vrai danger relève peut-être du système académique. « Les pressions à la rentabilité, à multiplier les publications et à accumuler les projets, impactent le choix des objets et des méthodes, poussent à aller trop vite. C’est cela qui menace la recherche scientifique ». Florence Delmotte conclut : « Au FNRS, nous sommes relativement protégés, mais cela doit continuer ».
Delphine Pouppez
[1] Voir les travaux du sociologue Dominique Raynaud.
[2] Bronner, Gérald ; Géhin, Étienne. Le danger sociologique. Presses Universitaires de France (2017).
[3] Heinich, Nathalie. "Ce que le militantisme fait à la recherche." Paris : Tracts Gallimard (2021).
L’intro et le sommaire du dossier : Sur les traces de la méthode scientifique

