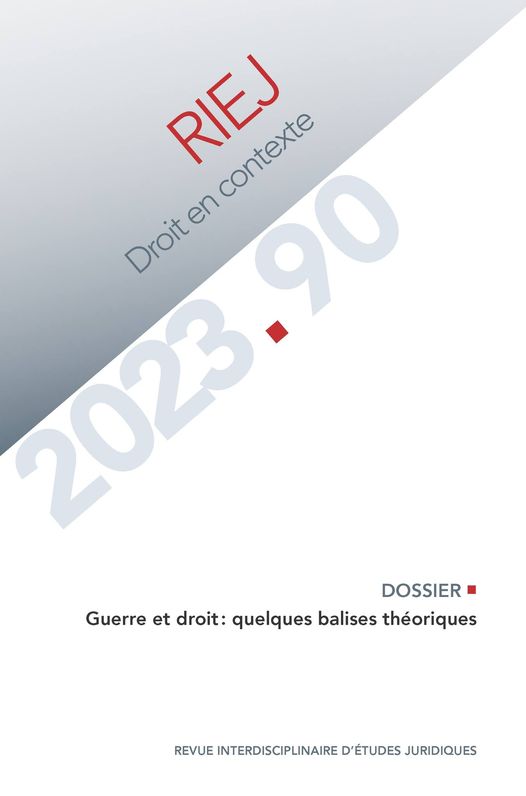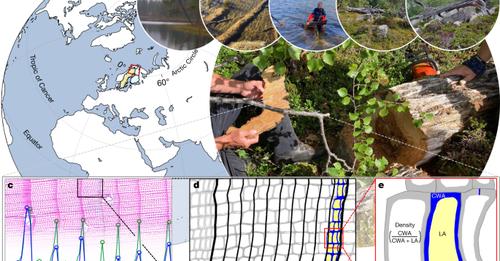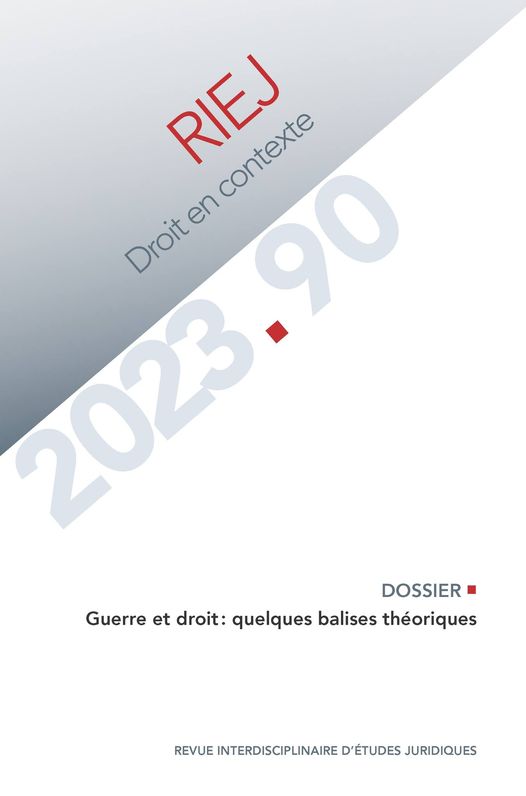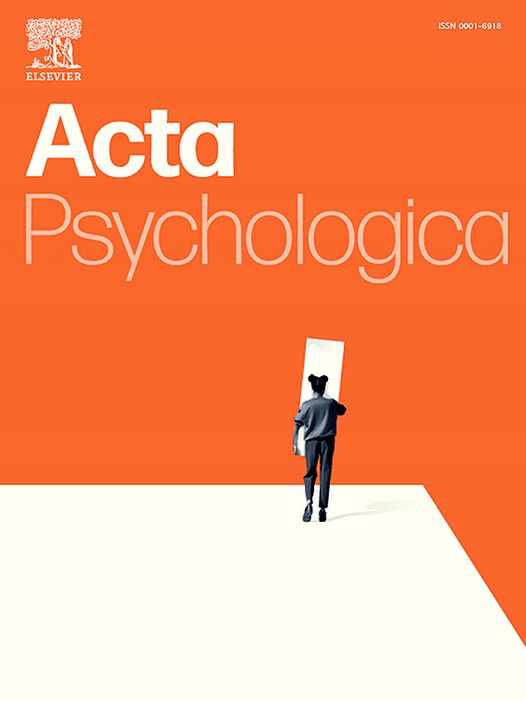➡ Dans la Revue interdisciplinaire d'études juridiques 2023/1 (Volume 90), Quentin Landenne, Chercheur qualifié FNRS Université Saint-Louis - Bruxelles et Arthur Moury, Aspirant FNRS Université Saint-Louis - Bruxelles reviennent, pages 285 à 295, sur "Narrations de la norme".
➡ Ce volume "Narrations de la norme", édité par Jacqueline Guittard, Émeric Nicolas et Cyril Sintez, s’inscrit dans un vaste courant qu’il est convenu de désigner comme le tournant narratif des sciences humaines et sociales et qui regroupe des projets de recherche très hétérogènes ayant en commun l’attention particulière portée à la dimension narrative des discours et phénomènes sociaux.
➡ En droit, ce courant a pris un vif essor depuis quelques années, notamment avec le riche champ d’études en Law and Literature. Les éditeurs du volume ont cependant voulu élargir leur champ d’investigation non seulement au-delà des rapports entre droit et littérature, mais au-delà du droit positif au sens strict, pour interroger la dimension narrative de « l’univers des normes » en général (p. 15). Les normes, peut-on lire dès l’introduction du volume, qu’elles soient juridiques ou extra-juridiques, sont constituées par un « processus de mise en récit » qui mérite d’être étudié de manière « perspectiviste », en tenant compte de la pluralité des formes de normativité qui se croisent et entrent en concurrence.
➡ L’hypothèse de départ du volume est que les normes sont non seulement constituées par des mises en récit, mais que celles-ci, par la continuité narrative qu’elles produisent, contribuent à masquer (ou à démasquer) les éléments de contraintes, de conflits et de discontinuités impliqués dans les normes.
➕ En savoir plus...