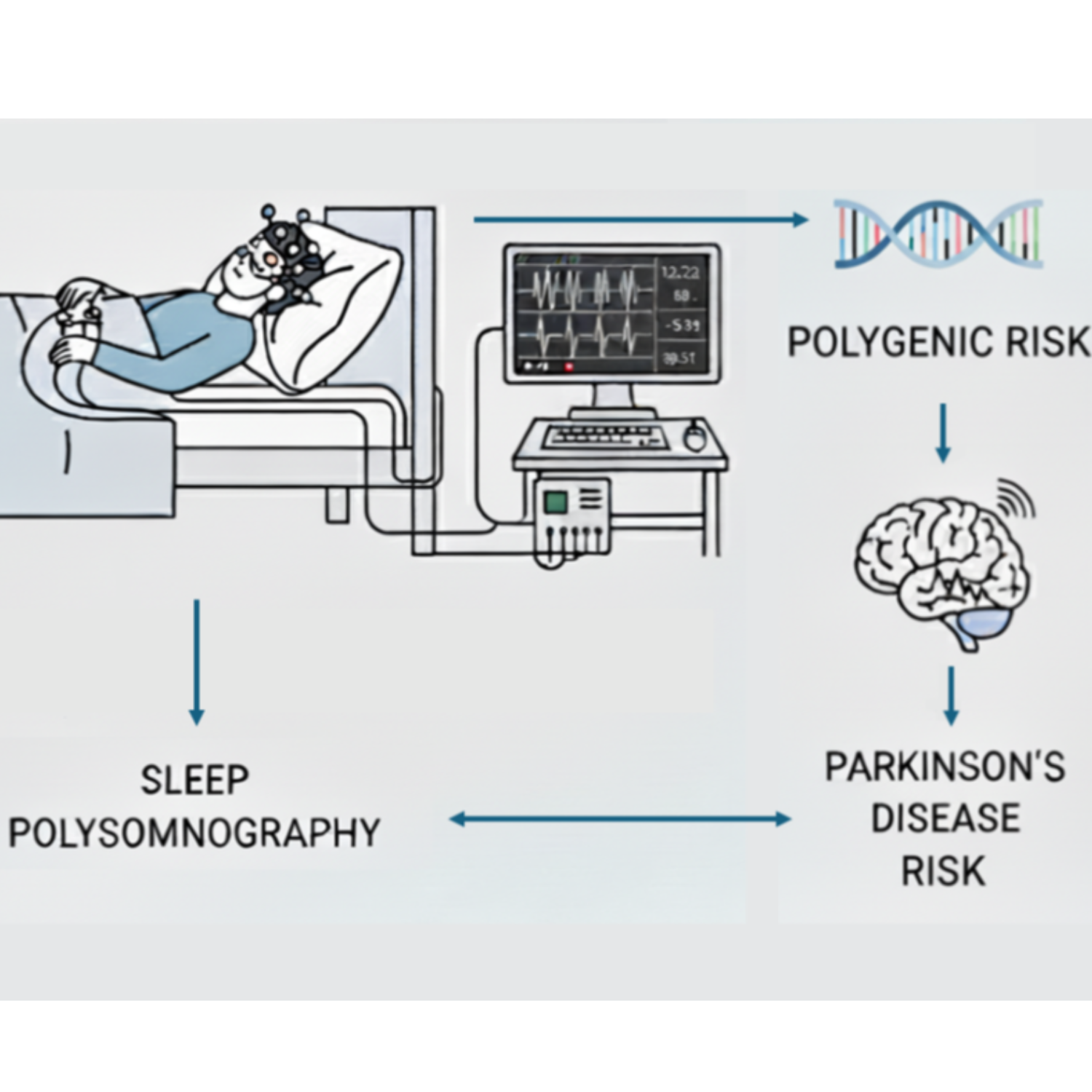Journée internationale des femmes et des filles de science
Quels sont les enjeux liés au fait d’être une femme dans le milieu de la recherche aujourd’hui ? À l’occasion de la Journée internationale des femmes et des filles de science, deux chercheuses FNRS à des stades différents de leur carrière livrent un témoignage croisé. Vinciane Debaille est Directrice de recherches FNRS à l’ULB. Cette géologue est connue pour ses nombreuses expéditions scientifiques en Antarctique. Stéphanie Herkenne est Chercheuse qualifiée FNRS à l’ULiège et cheffe du laboratoire de mitochondrie au GIGA. Cette biochimiste travaille sur l’identification de nouvelles cibles thérapeutiques dans la lutte contre le cancer. Toutes deux se confient sur les obstacles rencontrés, les évolutions observées, ainsi que les messages qu’elles souhaitent transmettre.
Les enjeux, liés au genre sont-ils plus ou moins marqués dans votre domaine de recherche par rapport à d’autres disciplines (SHS, SVS, SEN) ?
Vinciane Debaille : Je dirais que non. Nous avons une discipline qui est assez féminine de manière générale, mais cela n’a pas toujours été le cas. En géologie (SEN), on effectue beaucoup de travail sur le terrain. À titre d’exemple, les plateformes pétrolières ont été interdites aux femmes pendant des années, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. Il existe également des terrains situés dans des zones potentiellement plus difficiles, où, traditionnellement, les femmes n’accompagnaient pas les équipes masculines. Ainsi, il est vrai que, historiquement, dès qu’il s’agissait de terrain, cette discipline a sans doute été davantage masculine. Les temps changent, et aujourd’hui, on trouve des femmes et des équipes très féminines même en Antarctique. Nous avons donc observé une évolution au cours des vingt dernières années.
Stéphanie Herkenne : J’évolue dans le domaine des sciences de la vie et de la santé (SVS), où la proportion de femmes est déjà élevée durant les études universitaires et doctorales. Historiquement, les postes de chercheurs qualifiés étaient davantage occupés par des hommes, mais cette tendance a clairement évolué. Aujourd’hui, on observe une présence croissante de femmes à ces niveaux de carrière, ce qui reflète une dynamique plus équilibrée dans le domaine.
En avançant dans votre carrière, les obstacles sont-ils plus ou moins nombreux ?
V.D. : Ce n’est pas quelque chose que j’ai rencontré dans ma carrière, même si je sais que ce n’a pas toujours été le cas pour des collègues d’une génération au-dessus de la mienne.
Ce que j’ai pu observer, ce sont plutôt de petites phrases par-ci par-là, que l’on entend de temps en temps. Cela est valable dans toutes les disciplines. Il existe également un aspect culturel : pour une femme, il peut être plus difficile, par exemple, de se faire entendre en réunion. Ce sont des dynamiques que l’on peut remarquer, mais elles relèvent davantage du culturel que d’un véritable obstacle dans ma carrière.
S.H. : Personnellement, je n’ai jamais ressenti d’obstacles majeurs directement liés au fait d’être une femme. Les questionnements ont surtout été internes, notamment la crainte de ne pas pouvoir concilier une carrière scientifique exigeante avec une vie de famille. Aujourd’hui, en tant que mère de deux jeunes garçons de 3 et 5 ans, je peux dire que ces inquiétudes étaient largement liées au stress et aux projections personnelles plutôt qu’à des barrières réelles.
Avez-vous constaté une évolution de la place des femmes dans la recherche depuis le début de votre carrière scientifique ? Quels changements vous semblent les plus significatifs ?
V.D. : Oui, évidemment, nous avons pris conscience de ce plafond de verre. Ce qui est significatif, c’est de réfléchir maintenant à la manière de le surmonter, tout en constatant que nous n’y sommes pas encore forcément parvenus. Culturellement, une femme aura plutôt tendance à accompagner son mari que l’inverse. C’est typiquement ce que nous venons de discuter à l’ERC (European Research Council), concernant les interruptions de carrière, les congés de maternité… Aujourd’hui, ce sont surtout les femmes qui connaissent ces « trous » dans leur CV. C’est un point particulièrement sensible sur lequel nous avons été briefés : il ne faut pas que ces interruptions soient préjudiciables quand on juge un dossier. Une interruption de carrière n'enlève rien à la créativité ou la capacité à accomplir de très bonnes expériences scientifiques.
S.H. : Oui, clairement. Le nombre de femmes occupant des postes académiques et de recherche a augmenté, et des avancées importantes ont été réalisées, notamment la prise en compte des congés de maternité dans l’évaluation des parcours et des demandes de financements. Toutefois, alors que les congés de paternité sont aujourd’hui davantage valorisés — ce qui est une évolution positive — je m’interroge sur un possible effet paradoxal qui pourrait, à terme, ralentir certains progrès obtenus.
La question de la conciliation entre la vie personnelle et la carrière scientifique se pose-t-elle différemment pour les femmes et pour les hommes ?
V.D. : Je dirais que c’est quelque chose d’assez complexe. La carrière scientifique est particulière, car un scientifique ne cesse jamais de réfléchir. Il arrive parfois que des idées surgissent dans des moments inattendus, comme sous la douche, et que l’on se dise :
« Aujourd’hui, je vais essayer ceci. » En tant que scientifique, on ne s’arrête jamais de penser. C’est donc un métier où, même lorsque l’on rentre à la maison, on a rarement
« fermé la porte » du laboratoire. Cela signifie, pour les hommes comme pour les femmes, qu’il faut parfois concilier un enfant qui pleure avec une proposition à rédiger pour le lendemain.
À nouveau, traditionnellement et culturellement, ce sont généralement les femmes qui abandonnent alors un projet. Cependant, il faut le noter : les temps changent, et les hommes prennent également leurs responsabilités.
S.H. : Je pense que oui. Les femmes restent souvent plus impliquées dans la vie quotidienne et scolaire des enfants. Cette charge mentale et organisationnelle pèse encore majoritairement sur les mères, ce qui peut influencer la manière dont elles vivent et organisent leur carrière scientifique.
5) Quel message souhaiteriez-vous faire passer auprès des jeunes femmes qui se lancent dans une carrière scientifique ?
V.D. : J’aimerais ne faire passer aucun message, car il ne faudrait pas se poser la question. C'est une question complexe car j'aurais aussi tendance à dire que l’on ne devrait pas se poser la question et motiver une personne à se lancer en science. Il faut d'abord aimer les sciences, et là, le problème est plus profond qu’au seul niveau universitaire, c’est un travail qui doit être réalisé dès le niveau secondaire. D'un autre côté, on constate que les femmes ont souvent davantage de difficultés à avoir confiance en elles, et c’est vraiment sur cet aspect qu’il est possible d’agir. Par exemple, il y a des études qui montrent que si on dit aux filles qu'elles sont moins bonnes en math que les garçons, alors elles réussissent moins bien que si on leur avait dit le contraire avant le test. En tant que femme, il faut donc apprendre à se faire confiance, même si cela est plus facile à dire qu’à faire.
S.H. : Je souhaiterais leur dire de ne pas se limiter elles-mêmes. Il est essentiel de se faire confiance et d’oser. Il est tout à fait possible de mener une carrière scientifique ambitieuse tout en étant mère de famille, et de s’y épanouir pleinement.
Stéphanie Lafontaine